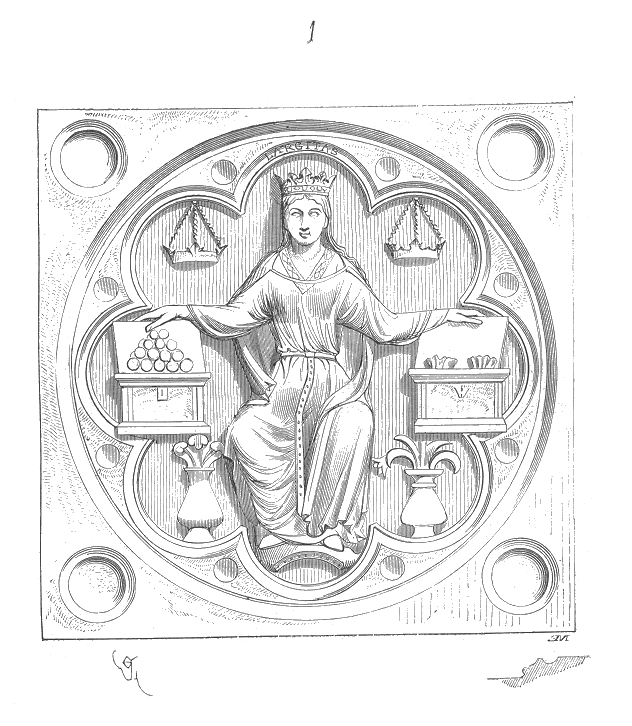La vertu désigne l’effort pour se bien conduire. C’est une force qui agit, ou qui peut agir. Vertu, c’est puissance, mais puissance spécifique. La vertu d’un être, c’est ce qui fait sa valeur. Les vertus sont indépendantes de l’usage qui en est fait, comme de la fin qu’elles visent ou servent. La vertu, c’est ce qui nous distingue des animaux, disait Aristote. C’est ce qui définit notre humanité à la jonction de l’hominisation et de l’humanisation. La vertu s’enseigne plus par l’exemple que par les livres.
Qu’est-ce qu’une vertu ? C’est une force qui agit, ou qui peut agir. Ainsi la vertu d’une plante ou d’un médicament, qui est de soigner, d’un couteau, qui est de couper, ou d’un homme, qui est de vouloir et agir humainement. Ces exemples, qui viennent des Grecs, disent assez l’essentiel : vertu c’est puissance, mais puissance spécifique. La vertu d’un être, c’est ce qui fait sa valeur, autrement dit son excellence propre : le bon couteau c’est celui qui excelle à couper, le bon remède celui qui excelle à soigner, le bon poison celui qui excelle à tuer…
Les vertus sont indépendantes de l’usage qui en est fait, comme de la fin qu’elles visent ou servent. Le couteau n’a pas moins de vertu dans la main de l’assassin que dans celle du cuisinier, ni la plante qui sauve davantage de vertu que celle qui empoisonne.
Sa puissance spécifique commande aussi son excellence propre. Un excellent couteau, dans la main d’un méchant homme, n’est pas moins excellent pour cela. Vertu c’est puissance, et la puissance suffit à la vertu. Aristote répondait que c’est ce qui les distingue des animaux, autrement dit la vie raisonnable.
Mais la raison n’y suffit pas : il y faut aussi le désir, l’éducation, l’habitude, la mémoire… Le désir d’un homme n’est pas celui d’un cheval, ni les désirs d’un homme éduqué ceux d’un sauvage ou d’un ignorant. Toute vertu est donc historique, comme toute humanité, et les deux, en homme vertueux, ne cessent de se rejoindre : la vertu d’un homme, c’est ce qui le fait humain, ou plutôt c’est la puissance spécifique qu’il a d’affirmer son excellence propre, c’est-à-dire (au sens normatif du terme) son humanité.
La vertu, une façon d’être
La vertu est une manière d’être, expliquait Aristote, mais acquise et durable : c’est ce que nous sommes, parce que nous le sommes devenus. Et comment, sans les autres hommes ? La vertu advient ainsi à la croisée de l’hominisation (comme fait biologique) et de l’humanisation (comme exigence culturelle) : c’est notre manière d’être et d’agir humainement, c’est-à-dire (puisque l’humanité, en ce sens, est une valeur) notre capacité à bien agir.
« Il n’est rien si beau et légitime, disait Montaigne, que de faire bien l’homme et dûment. » C’est la vertu même. Spinoza : « Par vertu et puissance j’entends la même chose ; c’est-à-dire que la vertu, en tant qu’elle se rapporte à l’homme, est l’essence même ou la nature de l’homme en tant qu’il a le pouvoir de faire certaines choses se pouvant connaitre par les seules lois de la nature » ou de son histoire.
Vertu, au sens général, c’est puissance ; et au sens particulier : humaine puissance ou puissance d’humanité. C’est ce qu’on appelle aussi les vertus morales, qui font qu’un homme semble plus humain ou plus excellent, comme disait Montaigne, qu’un autre, et sans lesquelles, comme disait Spinoza, nous serions à juste titre qualifiés d’inhumains.
Cela suppose un désir d’humanité, désir évidemment historique (il n’y a pas vertu naturelle), sans lequel toute morale serait impossible. Il s’agit de n’être pas indigne de ce que l’humanité a fait de soi, et de nous. La vertu, depuis Aristote, est une disposition acquise à faire le bien. Mais il faut dire plus : elle est le bien même, en esprit et en vérité.
Telle est la vertu : c’est l’effort pour se bien conduire, qui définit le bien dans cet effort même. Toute vertu est un sommet, entre deux vices, une ligne de crête entre deux abîmes : ainsi le courage, entre lâcheté et témérité, la dignité, entre complaisance et égoïsme, ou la douceur, entre colère et apathie… Mais qui peut vivre toujours au sommet ? Penser les vertus, c’est mesurer la distance qui nous en sépare. Penser leur excellence, c’est penser nos insuffisances ou notre misère. Il est une vertu toutefois qu’elle développe : c’est l’humilité, aussi bien intellectuelle, devant la richesse de la matière et de la tradition, que proprement morale, devant l’évidence que ces vertus nous font défaut.