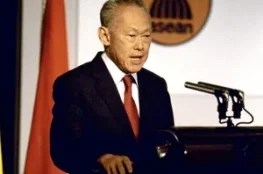Sous l’épitaphe d’Anouar el-Sadate, on peut lire ces quelques mots « Héros de guerre et de paix. Il a vécu pour la paix et est mort en martyr pour ses principes ». Sadate s’était toujours tenu à l’écart du maelstrom. De nature solitaire, il gardait une certaine perspicacité et indépendance d’esprit.
Anouar el-Sadate était à la base des accords d’Oslo entre Israël et la Palestine, de la paix entre Israël et la Jordanie et de la normalisation des relations diplomatiques israéliennes avec les Emirats arabes Unis, Bahreïn, Soudan et Maroc.
« Lorsque, enfermé dans ma sombre prison, j’avais envisagé la vie et la nature humaine, cette réflexion m’avait enseigné quelque chose : celui qui n’est pas capable de transformer le tissu même de sa pensée ne sera jamais à même de transformer la réalité et ne fera donc jamais de progrès » Anouar el-Sadate
L’Egypte oscilla pendant des siècles entre deux identités culturelles. La première trouvait sa source dans l’antique royaume méditerranéen d’Egypte dans la dynastie ptolémaïque, tourné vers la Grèce et vers Rome. Dans ce cadre, l’Egypte occupa une place prédominante durant la période hellénistique et au début de l’empire romain. Alexandrie était la plaque tournante du monde antique, et les rives fertiles du Nil produisaient une grande partie des céréales consommées dans l’ensemble du bassin méditerranéen.
La seconde identité du pays, plus récente d’un Etat islamique tourné vers la Mecque, fut redynamisée aux 18ème et 19èmes siècles par des expansionnistes comme le Mamelouk-Ali Bey et le commandant militaire ottoman Mehemet-Ali, qui ambitionnaient d’influencer et de conquérir l’Arabie et le Levant. En 1805, après l’éphémère incursion de Napoléon en Egypte. Mehmet-Ali se déclara premier khédive l’équivalent approximatif d’un vice-roi sous la suzeraineté ottomane et fonda une dynastie qui gouvernerait l’Egypte pendant les cent cinquante années suivantes ; ses descendants prendraient, eux-aussi, le titre de Khédive. La vision égyptienne moderne est donc née en grande partie, mais pas intégralement, à travers un prisme islamique.
La disgrâce du souverain égyptien, les tensions de la Seconde Guerre Mondiale et l’humiliation de la défaite de 1948 avaient renforcé le sentiment antibritannique de l’opinion publique égyptienne. En octobre 1951, le parlement égyptien abrogea unilatéralement le traité anglo-égyptien de 1936. Car il avait été le fondement de la présence militaire britannique persistante autour du canal de Suez. Un conseil de régents fut mis en place pour administrer la monarchie, l’usage le voulait lorsque le souverain était mineur. Le vrai pouvoir était détenu par le conseil du commandement de la révolution (CCR), dirigé par le général Naguib.
Plusieurs projets d’ampleur furent lancés notamment l’investissement dans l’industrialisation et l’éducation, la réforme agraire (qui affaiblit l’aristocratie et supprime les titres). Anouar el-Sadate savait pertinemment que la souveraineté de l’Egypte passait par son indépendance économique. In fine, le projet de construction du barrage d’Assouan fut lancé, un ouvrage destiné à contrôler le débit du Nil, à limiter les inondations, à accroître la superficie des terres arables du pays et à produire de l’énergie hydraulique. En décembre 1955, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Banque mondiale acceptèrent de financer ce projet.
Le 26 juillet 1956, Nasser annonça la nationalisation de la compagnie et créa à sa place l’autorité du canal de Suez, une société nationale. Ainsi, l’Egypte engrangerait dorénavant les droits de péage du canal, la route maritime la plus rapide et la plus empruntée pour se rendre d’Europe en Asie. Ces nouveaux revenus provenant du canal de Suez seront alloués à la construction du barrage d’Assouan.
La guerre des six jours, menée en juin 1967 du côté arabe par les forces conjointes de l’Egypte, de la Syrie et de la Jordanie, s’acheva par une victoire israélienne qui permet à Israël de tripler ou presque, la surface de son territoire, de poster ses forces sur le canal de Suez et d’humilier ses voisins arabes. Cette défaite embarrassa Nasser au point de démissionner de la présidence le 9 juin 1967.
Anouar el-Sadate, la révolution corrective
« Un morceau de terre contre un morceau de paix »
En juillet 1972, le gradualisme de Sadate céda la place à une action spectaculaire : l’expulsion soudaine d’Egypte d’environ 20.000 conseillers soviétiques, sans avertir Moscou et sans consulter un pays occidental.
« J’ai un plan pour vous. Je l’ai appelé le plan Kissinger », par ces paroles Anouar el-Sadate voulait mettre fin au statu quo et ouvrir une possibilité de négociation avec Israël sous les auspices américains. Son principal objectif était de mettre fin au conflit avec Israël qui atrophiait l’énergie égyptienne depuis la guerre de juin 1967.
L’accord du Sinaï, constitue une nouvelle étape vers la paix. Yitzhak Rabin, est le premier sabra (israélien de naissance) à accéder au poste de chef de gouvernement. Rabin et Sadate exploraient la voie des négociations par une médiation américaine, quant au retrait israélien, au-delà des cols du Sinaï central cette fois. Rabin s’attendait à une déclaration égyptienne de non-belligérance.
Un héritage inachevé
« Ne comptez pas ceux qui sont tués au nom d’Allah comme morts, mais comme vivants, au paradis du tout puissant. » Verset du coran
La force de l’Egypte réside dans son aspiration à une identité éternelle. Au confluent du monde arabe et de la Méditerranée. Véhiculant des valeurs de tolérance, compassion et magnanimité. Anouar el-Sadate était un homme patient et serein. Il se situait dans la perspective de l’Egypte antique, considérant l’accomplissement comme le déploiement de l’éternité.
L’accord de paix durable israélo-égyptien, l’accord parallèle entre Israël et la Jordanie, les accords d’Abraham en 2020 qui constitue une série de normalisations entre Israël et les pays arabes ; Ipso facto, donnent raison à Sadate. Cependant la guerre Israël-Gaza débuté le 7 octobre 2023, ravive les tensions entre les pays arabes et Israël.
Source : Henry Kissinger « Leadership »