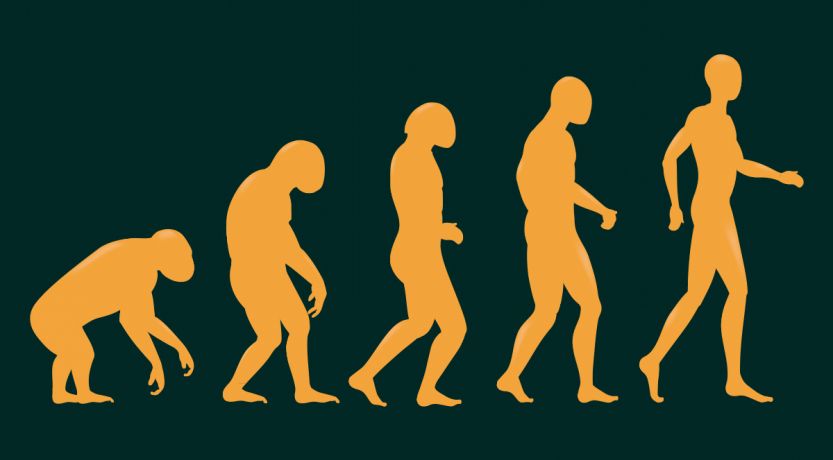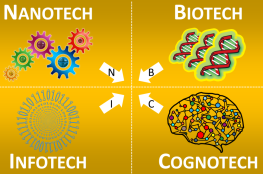La vie sur Terre est une forme complexe d’organisation de la matière et de l’énergie qui composent notre Univers. Prodige de complexité et d’organisation, le fœtus contient en lui des milliards d’années d’évolution, de transformation de la matière vivante en relation avec l’évolution de notre planète. Toutes les formes de vie sur Terre sont des descendants d’une molécule (ADN) apparue il y a environ 3,5 milliards d’années. Le code génétique est universel, mais l’ordre dans lequel sont agencées les lettres constitue la signature du génome d’une espèce.
« Si vous chauffez un liquide par en-dessous, il se produit des tourbillons dans lesquels des milliards de milliards de molécules se suivent l’une l’autre. De même, un être vivant (…) est un ensemble de rythmes, tels : le rythme cardiaque, le rythme hormonal, le rythme des ondes cérébrales, de division cellulaire… Tous ces rythmes ne sont possibles que parce que l’être vivant est loin de l’équilibre. Le non-équilibre, ce n’est pas du tout les tasses qui se cassent ; le non-équilibre, c’est la voie la plus extraordinaire que la nature ait inventée pour coordonner les phénomènes, pour rendre possibles des phénomènes complexes. Donc, loin d’être simplement un effet du hasard, les phénomènes de non-équilibre sont notre accès vers la complexité. » Ilya Prigogine, Chimiste et Physicien
Théorie de l’évolution
Le domaine de la théorie : les êtres vivants. Les objets de la théorie de l’évolution, comme de toute la biologie, sont les êtres vivants. Les êtres vivants sont des objets historiques, dont l’existence est restreinte à un lieu précis de l’Univers et à une époque précise de son histoire. Le lieu est la surface de la Terre, autour de laquelle la matière vivante forme une couche mince appelée biosphère. L’époque est une période relativement récente dans l’histoire de l’Univers, c’est-à-dire, les quatre derniers milliards d’années. C’est en effet dans des roches âgées de 3 à 4 milliards d’années qu’on trouve les premières traces d’êtres vivants, des fossiles d’organismes proches des cyanobactéries actuelles.
Les êtres vivants ne sont pas seulement des assemblages statiques de structures d’organes répondant à des programmes dictés par les gènes, par l’ADN. Ils sont, bien au contraire, des « territoires dynamiques », toujours en mouvement, où une grande diversité de molécules interagit en permanence pour créer et ajuster des « fonctions », des activités en adéquation avec les contraintes de leur environnement immédiat.
La vie sur Terre est une forme complexe d’organisation de la matière et de l’énergie qui composent notre Univers. Cette organisation dynamique, et donc éphémère, tire son ordre de l’utilisation et de la dissipation d’énergie. In fine, la vie ne peut exister dans un monde en déséquilibre énergétique, en « non-équilibre » comme l’écrivait Prigogine, fait de gradients d’énergie. La vie est simplement une forme particulière de la matière et de l’énergie, un « phénomène » qui devait apparaitre nécessairement dans notre Univers.
Les interactions des molécules et des organismes forgent une dynamique de changement. Ainsi, les organismes océaniques qui nous ont précédés sur Terre pendant près de 4 milliards d’années se sont complexifiés progressivement par le jeu d’une diversification des gènes et des protéines, associée à toute une série d’événements symbiotiques et d’interactions des différents royaumes de la vie.
Prodige de complexité et d’organisation, le fœtus contient en lui des milliards d’années d’évolution, de transformation de la matière vivante en relation avec l’évolution de notre planète. En 1830, Karl Ernst von Baer, Russo-allemand originaire d’Estonie, décrit en détail la complexité du développement embryonnaire. Il identifie l’apparition précoce de trois « feuillets », des couches de cellules qui, en se repliant, forment les organes, puis l’organisme tout entier. Chez des espèces différentes, les formes précoces par lesquelles passent les embryons pendant la fabrication d’un animal adulte sont universelles. Cependant, le développement embryonnaire suit ensuite des voies divergentes, avec pour résultat la diversité de formes des espèces.
Homo sapiens
En réalité, l’Homme appartient à l’ordre des primates, plus précisément à la sous-branche des singes de l’Ancien Monde (hominidés) : nos plus proches cousins sont les chimpanzés et les bonobos, un peu plus éloignés, les gorilles puis les orangs-outans. Depuis les années 2000, le séquençage (lecture de l’ADN) de notre espèce, puis du chimpanzé, du bonobo, du gorille et dernièrement de l’orang-outan, a permis de comparer ces espèces et d’en préciser la généalogie. Grâce à quatre petites lettres : A, C, T et G. Ces quatre lettres (initiales de quatre molécules qui constituent l’ADN) forment l’alphabet avec lequel est écrit le génome de tous les êtres vivants sur Terre.
Toutes les formes de vie sur Terre sont des descendants d’une molécule apparue il y a environ 3,5 milliards d’années. Nous avons hérité de la même machinerie génétique qui permet de lire les informations contenues dans l’ADN. Le code génétique est universel, mais l’ordre dans lequel sont agencées les lettres constitue la signature du génome d’une espèce. Par exemple, l’ADN humain aligne trois milliards de nucléotides (le nom sous lequel on regroupe les molécules A, C, T et G), soit l’équivalent d’un texte de 750 000 pages. Ce n’est qu’en 2001 que les biologistes sont parvenus à lire la succession de lettres.
Grâce à ce travail, les chercheurs ont su évaluer qualitativement à quel point nous sommes proches des grands singes. Notre ADN est similaire à celui du chimpanzé à 98,8%. Soit, seul 1,2% de notre génome nous sépare de lui. L’ADN humain renfermant 3 milliards de paires de nucléotides, ce 1,2% correspond tout de même à 35 millions de différences, toutes survenus au hasard au fil du temps.
A part les 1,2% de différence, on remarque que lorsqu’on aligne côte à côte l’ADN humain et celui du chimpanzé : certaines parties du génome existent dans une espèce et pas dans l’autre. Les biologistes désignent par le terme insertion l’ajout d’un fragment d’ADN et par délétion la perte d’un morceau. Au fil de la chaîne ADN, ces dissemblances sont moins fréquentes que les mutations, mais, comme elles concernent de longues séquences de nucléotides (molécules de base de la double hélice), elles représentent une plus grande proportion du génome. Ainsi, 500 000 insertions/délétions exprimeraient notre singularité d’avec les chimpanzés pour un total de 90 millions de nucléotides.
Malgré l’ubiquité de notre espèce, c’est elle qui possède le niveau de diversité génétique le plus faible : nous sommes tous identiques à 99,9%. Si l’on compare lettre à lettre l’ADN de deux humains sur la planète, en moyenne une lettre sur mille sépare deux individus. Cette valeur est faible comparée aux autres grands singes : les chimpanzés d’Afrique centrale ont environ deux fois plus de différences génétiques entre eux que deux humains. Quant aux orangs-outans de Bornéo, ils sont trois fois plus divers génétiquement que les humains.
En comparant l’ADN d’enfants à ceux de leurs parents (père et mère), il est possible de compter directement le nombre de nouvelles mutations qui apparaissent à chaque génération. Chaque individu porte environ 70 nouvelles mutations (entre 20 et 40 apparaissent sur l’ADN maternel et entre 20 et 40 sur l’ADN paternel). Or ce nombre est très variable et atteint parfois plus de 100. Il dépend de l’âge du père au moment de la naissance de l’enfant. Plus le père est âgé, plus le nombre de mutations est élevé, alors que l’âge de la mère n’a presque pas d’influence.