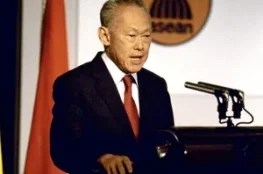Le rôle des leaders est d’aider à guider ce choix et d’inspirer leurs peuples dans son exécution. Margaret Thatcher surnommée la « Dame de fer », était intransigeante sur sa politique et son style de leadership, notamment en ce qui concerne le communisme en Union Soviétique. Ses convictions, ses décisions et son style de leadership sont connus sous le nom de « thatchérisme », un réalignement vers des politiques néolibérales au Royaume-Uni.
Née le 13 octobre 1925 à Grantham, au Royaume-Uni. Par la suite, Margaret Thatcher s’éloigne de la demeure familiale de Grantham, mais elle n’oublie jamais ses valeurs qui lui avait inculquées sa famille et sa foi : discipline, économie, compassion et soutien concret. Sa rhétorique et sa politique contrasteraient vivement avec la sagesse conventionnelle guindée à laquelle elle attribuait la stagnation de la Grande-Bretagne.
Femme de principe, sa force résidait dans une volonté indomptable et efficiente. Son leadership résidait dans sa capacité à s’adapter aux contraintes de la réalité sans renoncer pour autant à sa largeur de vues. Charles Powell, principal conseiller en politique étrangère de la Première ministre Margaret Thatcher dans les années 1980, la décrit en ces termes : « comme un officier de marine sensé, elle savait quand s’enfumer et se retirer pour éviter des défaites tactiques, mais ne perdait jamais de vue son objectif ultime et continuait à se battre pour y parvenir ».
Par ailleurs, Margaret Thatcher ne faisait pas partie du sérail. Ses succès se nourrissaient d’une grande force d’âme personnelle. Ferdinand Mount, chef de l’unité de police du 10 Downing Street (1982-1983), a décrit ses réformes en ces termes : « Elles ne signalent pas par leur originalité, mais par leur exécution. Le courage politique ne résidait pas dans le fait de les mettre en pratique mais dans la création des conditions permettant de les mettre en principe ».
De même, Margaret Thatcher considérait l’inflation comme une menace contre l’intérêt national : « l’inflation détruit les nations et les sociétés avec la même brutalité que les armées d’envahisseurs, déclara-t-elle aux conservateurs. L’inflation et le chômage sont liés, comme les membres d’une même famille. C’est le voleur invisible, qui vient dérober les économies de ceux qui ont épargné ». Les réformes de Thatcher transformèrent irrémédiablement la Grande-Bretagne. Sous son gouvernement, les conservateurs levèrent les contrôles sur le commerce extérieur, supprimèrent les commissions fixes des échanges financiers et ouvrirent la bourse britannique aux opérateurs étrangers dans le cadre de ce qu’on a appelé le « Big Bang », qui fit de la Grande-Bretagne un centre financier international à la fin des années 1980. La politique conservatrice freina également les dépenses publiques, sans parvenir cependant à les réduire entièrement. Les impôts sur le revenu et sur les investissements baissèrent ; la taxe à la consommation augmenta. British Telecom, British Airways, British Steel et British Gas furent tous privatisés. Le nombre de Britanniques détenteurs d’actions quadrupla.
La guerre des îles Falkland
“Il ne faut pas ébranler la position stratégique ou la confiance en soi d’un proche allié sur une question qu’il considère comme d’une importance vitale. C’est un principe d’une pertinence contemporaine majeure. En ce sens, la crise des Falkland renforça en définitive la cohésion occidentale » Henry Kissinger
Les îles Falkland, situées à environ 500 kilomètres des côtes argentines doivent leur importance stratégique à leur proximité avec le cap Horn, la pointe australe du continent américain qui constitue, avec le détroit de Magellan, une voie de passage historique entre l’Atlantique et le Pacifique. En tant que leader, Margaret Thatcher inspira à ses collaborateurs la force d’aller au-delà de ce qui leur parait possible. Grâce à sa confiance légendaire, Thatcher poussa son gouvernement à ne pas baisser les bras. « Vous devez les repousser », « vous devrez le faire » dit-elle à Natt. Une fois que sa stratégie fut définie, Margaret Thatcher la mit en œuvre. Le coût total de la guerre des Falklands dépassa les 7 milliards de dollars. Comme l’écrit l’historien Andrew Roberts à propos de cette décision : « On aura rarement eu démonstration plus saisissante que des dépenses de défense relativement élevées constituent un bon rapport qualité/prix, car le combat est toujours beaucoup plus coûteux que la dissuasion ».
Modus Operandi de Margaret Thatcher
En tant que cheffe de guerre, elle a mis en place les paramètres avant de laisser les commandants de la flotte organiser la campagne à leur guise, tout en leur apportant un soutien inébranlable. S’ajoutant aux réformes économiques déterminantes que Margaret Thatcher avait menées dans le pays, la victoire des Falkland amplifie de façon impressionnante le prestige de la Grande-Bretagne sur la scène internationale.
Peu après, la guerre des Falkland, Thatcher a dû affronter un défi issu du passé colonial de la Grande-Bretagne : l’avenir de Hong Kong. Bien que l’île de Hong Kong soit devenue territoire britannique en 1842, les nouveaux territoires qui l’entourent n’avaient été gouvernés par la Grande-Bretagne qu’en vertu d’un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans accordés par la Chine, bail qui devait expirer en 1997. Rejetant les prétentions historiques de la Grande-Bretagne au sujet de ces dispositions, Pékin insista pour que les deux territoires repassent sous contrôle chinois en 1997, deux ans avant le cinquantenaire de la victoire du parti communiste chinois (PCC) sur les forces nationalistes de Tchang Kai-check. La Chine estimait que le contrôle britannique sur Hong Kong et sur les nouveaux territoires était une aberration historique. La position britannique reposait sur trois accords :
- Le traité de Nankin (1842) par lequel la Chine cédait définitivement à la Grande-Bretagne : l’île de Hong Kong.
- La convention de Kow Loon (1860) qui prévoyait la cession par la Chine d’une péninsule voisine.
- La convention pour l’extension du territoire de Hong Kong (1898) qui lui concédait un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans sur les nouveaux territoires.
En décembre 1984, Margaret Thatcher et Zhao signèrent la déclaration sino-britannique fixant le transfert de souveraineté au 30 juin 1997. Le traité ne prévoyait pas seulement les conditions dans lesquelles s’exercerait cette souveraineté : chose unique, il prévoyait un processus de cinquante ans au terme desquels ce territoire, ancienne possession britannique deviendrait un élément théoriquement autonome de l’Etat chinois. A l’exécution de la cession, comme stipulé dans cet accord, la souveraineté de la Chine sur Hong Kong coexisterait avec un état subsidiaire et subjectif d’« autonomie » pendant cinquante ans.
Le conflit avec l’Irlande du Nord
Les six comtés de l’Irlande du Nord étaient restés au sein du Royaume-Uni après la partition de l’Irlande en 1921. En 1985, Margaret Thatcher assura le succès de l’accord anglo-irlandais, un texte décisif dont l’objectif était de mettre fin aux troubles. Le conflit violent, vieux de plusieurs décennies, opposant en Irlande du Nord les unionistes essentiellement protestants et les nationalistes majoritairement catholiques.
Le 27 août 1979, l’armée républicaine irlandaises (IRA), imposa au nouveau Premier ministre Thatcher deux nouvelles épreuves de force, d’abord en tuant les 18 soldats britanniques dans une embuscade à proximité de la ville nord-irlandaise de Warrenpoint puis en assassinant Lord Mountbatten, cousin de la reine et ancien chef d’Etat-Major des armées. Parmi les victimes de cette dernière attaque figuraient, à part Lord Mountbatten, son petit-fils de quatorze ans, un ami de celui-ci, âgé de quinze ans, avec qui il faisait du bateau et la lady douairière Brabourne.
Finalement, l’accord anglo-irlandais fut une grande réussite diplomatique. Il n’aurait pas été possible si Thatcher n’avait pas maintenu les unionistes dans l’ignorance du fond des négociations, lequel s’il avait été connu, aurait probablement entraîné une grève des travailleurs protestants et paralysé la province. En définitive, la paix à laquelle elle aspirait fut le fruit de discussions directes entre les factions d’Irlande du Nord, des négociations dont son travail avait contribué à créer les conditions nécessaires. Malgré des défis apparemment insurmontables, elle posa les fondements d’une génération de paix relative en Irlande du Nord.
Doctrine Thatcher
« Nous ne recherchons la domination, l’hégémonie dans aucune partie du monde… Bien sûr, nous sommes prêts à mener la bataille des idées avec toute la vigueur dont nous sommes capables, mais nous n’essayons pas d’imposer notre système à autrui » Margaret Thatcher
« Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous répondrons à celles-ci » Epictète, philosophe stoïcien
L’étoile rouge, organe de presse du ministère soviétique de la Défense, traite Thatcher de « dame de fer ». Ce surnom, conçu comme une comparaison peu flatteuse avec Bismarck, eut l’effet inverse. Margaret Thatcher transforma cette prétendue insulte en titre de gloire et le qualificatif lui resta.
Dans la tradition politique britannique, le concept de l’équilibre des puissances passait pour axiomatique. Les dirigeants britanniques du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, acmé de l’influence britannique, ont compris l’importance d’entretenir des alliances dans une partie au moins du continent européen, tout en ayant des bases dans d’autres régions du monde. Quant à Margaret Thatcher, elle resta fixée sur l’importance d’une défense nationale solide et sur la nécessité de renforcer la cohésion de l’OTAN. Elle soutint les efforts de Ronald Reagan pour augmenter la crédibilité de l’Alliance.
Selon Margaret Thatcher, la communauté européenne était censée poursuivre cinq « idées forces », notamment :
- Une coopération volontaire et active entre Etats indépendants souverains.
- Adopter vis-à-vis des problèmes actuels une démarche qui soit pragmatique.
- Prendre des mesures en faveur de l’entreprise.
- Se garder du protectionnisme.
- Continuer à assurer une défense efficace par le biais de l’OTAN.
Source : Henry Kissinger « Leadership »