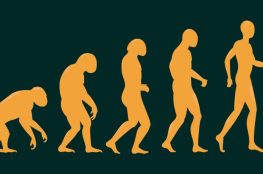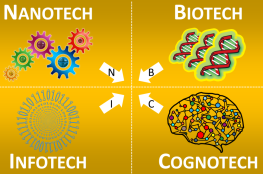Le pétrole conventionnel a franchi en 2008 un pic de production absolu. Ce record ne pourra plus jamais être battu, a confirmé l’Agence Internationale de l’énergie. Ce point fatidique a été dépassé à cause des limites géologiques de la planète. La première ruée vers l’or noir s’est produite en 1859, après le forage d’un puits du bord d’une petite rivière de Pennsylvanie à seulement vingt mètres de profondeur. L’expression « or noir » résume la facilité avec laquelle les pétroliers ont longtemps pu s’enrichir.
« Je crois en une vie près la mort, tout simplement parce que l’énergie ne peut pas mourir ; elle circule, se transforme et ne s’arrête jamais » Albert Einstein
« Celui qui croit en une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste » Albert Einstein
Energie vient du grec energeia, « la force en action ». Aujourd’hui, l’énergie désigne la capacité à effectuer des transformations. Dans l’Univers, elle se présente sous deux formes, atomiques et cinétiques (le mouvement). En physique, le terme est apparu au 18ème siècle, où il concerne alors uniquement le travail mécanique. Il se précise progressivement jusqu’au 20ème siècle, lorsque Einstein instaure une révolution en montrant que E = MC² : tout corps possède de l’énergie du seul fait qu’il possède de la masse. Et l’on peut transformer de l’énergie en masse, et réciproquement.
Lors des deux siècles écoulés, le bilan énergétique mondial se traduit par une courbe en hausse constante, avec le charbon, puis le pétrole… Toutes ces ressources s’entassent. C’est une première vision de l’histoire de l’énergie, celle d’une forme de conservatisme. Le charbon, utilisé en premier lieu dans l’industrie, sert ensuite à faire uniquement de l’électricité, le gaz employé pour le chauffage devient source d’électricité, le pétrole qui servait à produire de l’électricité et de la chaleur devient à 80% du carburant.
Après la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé que l’électricité devait remplacer les énergies traditionnelles dans le monde rural, notamment pour la modernisation de l’agriculture… A la fin du tout pétrole dans les années 1970, il fut décidé de diversifier la production électrique.
Par ailleurs, il existe plusieurs formes d’énergie notamment le thermique, l’électrique, la mécanique, le chimique, lumineuse ou de rayonnement, musculaire. De même, deux lois physiques régissent les multiples transformations de l’énergie :
- Conservation : on ne peut ni créer de l’énergie, ni la détruire. La quantité qui entre dans un système est égale à la quantité qui en sort, souvent sous une autre forme.
- Augmentation de l’entropie : L’énergie a toujours tendance à se disperser.
Il faut savoir que le cinquième de la population mondiale dépasse 4/5 de l’énergie totale. Or deux autres cinquièmes sont en cours de fort développement. Aussi, que le méthane (fuites des gazoducs et mines de charbon, émissions de vaches, des rizières, des déchets) est responsable d’environ 30% du réchauffement depuis la révolution industrielle. Que la concentration en CO² a augmenté de 51% depuis le début de l’ère industrielle. L’augmentation de la température globale atteint déjà 1,2°C. En 2020, une voiture vendue sur 25 était électrique. En 2023, une sur cinq.
Paradigme de l’énergie fossile
La société s’est construite depuis plusieurs siècles sur l’idée qu’en accédant aux énergies fossiles, elle aurait d’énormes capacités de développement. Avant la révolution industrielle, on pense que le progrès continu de la civilisation dépend de la technique, qui doit permettre au plus grand nombre d’accéder aux produits fabriqués. La société actuelle est le produit d’une dépendance au chemin : les décisions prises contraignent fortement les suivantes. Ipso facto, il est très difficile de sortir de cette trajectoire. Par exemple, le recours aux énergies fossiles a permis l’hypermobilité. Comment espérer conserver l’hypermobilité sans les énergies fossiles ?
D’ailleurs, au 19ème siècle, un économiste anglais a émis un paradoxe : plus on améliore l’efficacité d’une ressource, plus celle-ci est utilisée. Plus nos lampes sont économes en énergie, plus on en installe… C’est l’effet rebond, vérifié sur l’énergie.
Les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, procurent encore les quatre cinquièmes de l’énergie consommée dans le monde. Le pétrole est la principale d’entre elles, fournissant en 2019 un tiers de toute l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’économie.
Le pétrole appartient à une large famille de molécules d’hydrogène et de carbone de structure particulière : les hydrocarbures. Qu’ils se trouvent sous forme gazeuse (gaz naturel), liquide (pétrole « huile de roche ») ou solide (le bitume), les hydrocarbures figurent parmi les molécules les plus courantes de la création.
Le pétrole que l’on exploite aujourd’hui s’est formé depuis un milliard d’années, c’est-à-dire depuis qu’il existe sur cette planète des matières organiques issues d’êtres vivants. Il est principalement issu de la dégradation de plancton et de bactéries, au fond des lagunes et de mers archaïques. Le pétrole conventionnel est puisé dans des roches poreuses et perméables dites « réservoirs », scellées dans les profondeurs de la terre sous une couche de roche imperméable.
La genèse du pétrole s’établit sur des centaines de millions d’années : il s’agit d’une source d’énergie non renouvelable à l’échelle de l’histoire humaine. La question de l’épuisement du pétrole a toujours été posée dès l’origine de cette industrie, chaque fois que la production de puits ou de régions pétrolifères entières se mettait à décliner sans préavis.
Prédiction d’un géophysicien
Le géophysicien texan Marion King Hubbert est le premier à avoir prédit correctement la date de survenue d’un pic pétrolier majeur. En 1956, cet expert de la compagnie Shell affirma que la production de pétrole conventionnel des Etats-Unis, connait une croissance robuste, et la plus élevée au monde, passerait par un maximum vers la fin des années 1960, avant d’amorcer un irrémédiable déclin.
Hubbert tira sa prédiction d’un calcul mathématique simple, fondé sur une estimation délicate du montant des réserves américaines de brut. En 1970, la prévision de Hubbert se révéla exacte, et la production conventionnelle des Etats-Unis se mit à décroître année après année. Ce déclin se poursuit encore aujourd’hui. Il a pu être compensé à partir de 2008 de façon inattendue par le boum du pétrole de schiste.
Une fois le maximum atteint, une production mature peut être maintenue à un niveau stable durant un certain temps, d’autant que les réserves disponibles sont importantes. Ainsi, l’Arabie Saoudite, qui possède les plus vastes réserves conventionnelles de la planète, peut se permettre de préserver celles-ci afin de faire durer la manne aussi longtemps que possible.
La production maximale peut alors rester plusieurs années sur ce que les pétroliers appellent un « plateau ondulant ». C’est ce qui se passe pour le pétrole conventionnel au niveau mondial depuis le pic de 2008 : moyennant des efforts sans précédents, la production est maintenue proche de son maximum.
Selon les experts, la consommation mondiale a explosé et s’élève aujourd’hui à 102 millions de barils par jour, soit environ deux fois plus que dans les années 1990. Effectivement, c’est colossal, nous utilisons autant de pétrole que nous buvons d’eau : deux litres par jour en moyenne par habitant sur la planète, soit bien plus qu’un français, qui vit dans une économie très développée.
Le pétrole a permis l’explosion de la puissance économique mondiale, grâce notamment à ses multiples propriétés naturelles, notamment :
- Comme les autres énergies fossiles, il cumule des fonctions de stock et de flux, contrairement à l’électricité, qui ne se stocke pas.
- C’est une source d’énergie très dense, très performante pour les moteurs de voiture et équipements industriels. La seule qui soit plus dense, le minerai d’uranium, est bien plus compliquée à exploiter, alors qu’il est très simple de raffiner du pétrole.
- Il est liquide, ce qui permet de le mobiliser beaucoup plus facilement qu’une source gazeuse ou solide, simplement en utilisant la gravité et l’écoulement.
Vers une approche transversale de la consommation de l’énergie
Pour réduire de façon importante la consommation d’énergie, le Shift Project recommande une approche transversale et une planification. Ainsi, consommer moins quantitativement, mais beaucoup mieux qualitativement. La sobriété doit être assortie d’une efficacité énergétique renforcée : isolation des bâtiments, amélioration du rendement des appareils électriques, réduction de la consommation des voitures et des poids lourds, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage optimisé…
In fine, notre capacité à révolutionner notre mode de vie, à comprendre qu’aucune énergie n’est infinie. On peut illustrer la dureté du sevrage énergétique par cet exemple : Homo energeticus envoie et reçoit des mails sans compter, chacun parcourant environ 15.000 kilomètres de câbles sous-marins (…) pour arriver à son destinataire, même si ce dernier est dans le bureau d’à côté. Si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d’électricité au monde juste derrière la Chine et les Etats-Unis.
L’empreinte carbone du numérique représentait déjà, en 2021, entre 3% et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, c’est le numérique qui génère en l’homme une illusion de perspectives infinies. Ce qui engendre une consommation effrénée et compulsive de l’énergie.