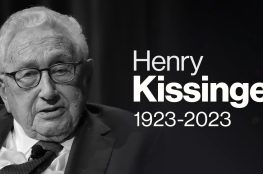Légende noire, homme changeant à une époque où le monde changeait à toute vitesse. Son extraordinaire carrière relate la fonction d’un diplomate, qui est un individu capable d’appréhender et de peser au mieux les intérêts supérieurs du pays qu’il sert dans un environnement changeant qu’il doit apprendre à connaître pour mieux espérer le pénétrer. Champion de l’équilibre durant un quart de siècle, ardent défenseur de la paix européenne, il fut à l’origine d’un nouvel ordre européen.
Né le 2 février 1754, fils aîné de la grande famille désargentée des Talleyrand-Périgord, souffrant d’un pied bot, handicap qui changea son destin : il fut envoyé au séminaire et il devint à l’issue de ses études au séminaire Saint-Sulpice puis à la Sorbonne un prêtre sans vocation, grand admirateur de Voltaire. Chanoine de la cathédrale de Reims, il devint par la suite de 1780 à 1785 agent général du clergé, chargé d’administrer les affaires temporelles de l’Eglise de France. Ce poste prestigieux lui permet de découvrir les jeux de pouvoir et la complexité des questions financières. Croisant le ministre des Affaires étrangères Vergennes, diplomate de premier ordre, prônant le maintien de la « balance » entre les Etats et l’évitement des guerres qui embrasaient systématiquement le continent entier par le biais du jeu des alliances.
La rupture avec l’Angleterre dès 1803 commença à refroidir son enthousiasme pour Bonaparte, dont la légitimité reposait sur le maintien des conquêtes révolutionnaires de la Belgique et de la rive gauche du Rhin, héritage de la guerre effrénée menée par la Convention, auxquelles le Premier consul rajoutait l’Italie du Nord. Le ministre considérait, au contraire, qu’une France trop puissante ne pouvait que menacer l’équilibre continental.
Talleyrand jouant dès lors le double rôle paradoxal de mauvais génie et de « bouche de la Vérité ». En mars 1804, il incita par exemple Bonaparte à faire fusiller le duc d’Enghien, lointain cousin de Louis XVI, accusé de conspirer contre la France, prouvant sa conviction que les intérêts de l’Etat passaient avant tout, même la vie d’un innocent. Après la proclamation de l’Empire, il devint grand chambellan en plus de son ministère. Ce titre honorifique rappelait à quel point Napoléon était fasciné par le protocole et avide d’hommages rendus à sa personne.
L’ascension
Dans les années qui suivirent, Talleyrand comprit le premier que l’Empereur voyait trop grand, trop loin, et qu’il commettait des erreurs majeurs : la reprise de la guerre dès 1805 contre l’Autriche et la Russie pouvait encore passer pour défensive, mais très vite, l’Empereur montra un grand appétit, humiliant les vaincus, instaurant le Blocus continental et imposant la mainmise de la France sur les petites et moyennes puissances de la « tierce Allemagne », brutalement réorganisée au sein de la Confédération du Rhin.
L’alliance de circonstance entre Talleyrand et Napoléon se brisa au moment où le premier céda pour de bon à sa soif de domination unilatérale. Le ministre lui répétait depuis des années que la France ne pouvait se passer d’un allié puissant, qu’il s’agit de l’Autriche ou de la Russie, mais le maître, « toujours empiétant, menaçant ou attaquant », comme le résume Taine, n’envisageait la diplomatie que sous l’angle du vasselage.
En 1814, alors que l’Empire s’écroulait, Talleyrand fit preuve d’une extraordinaire habileté en s’arrangeant pour rester à Paris quand la régente Marie-Louise battit en retraite devant l’avance russe. Seul grand dignitaire du régime dans la capitale occupée, il usa de ses prérogatives pour convoquer le Sénat, qui prononça la déchéance de l’Empereur et rappela Louis XVIII. Après s’être débarrassé de Napoléon exilé sur la minuscule île d’Elbe, il retrouva le portefeuille des Affaires étrangères au sein du gouvernement royal qui adopta la Charte, instaurant une monarchie constitutionnelle imparfaite : moins à l’aise avec les affaires intérieures, il échoua à percevoir la montée des mécontentements engendrée par la maladresse du gouvernement royal comme à analyser le jeu des partis.
Avènement d’un monde nouveau
« L’ennemi vaincu participait ainsi à la préservation de l’ordre européen au sein d’une alliance spécialement conçue pour l’endiguer » Henry Kissinger
Du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815, Talleyrand délocalisé en Autriche joua un rôle central au cours du congrès de Vienne, qui demeure son heure de gloire. On y croisait 216 délégations rassemblant 500 diplomates accrédités, accompagnés de leurs conseillers, amis, conjoints et domestiques. La délégation russe comptait 53 personnes, celle de la Prusse 46 et celle de l’Angleterre 25, alors que la France n’affichait que 15 collaborateurs, tous triés sur le volet et aptes aux mondanités. Les souverains se mêlèrent fort peu des discussions concrètes, la diplomatie passant désormais – l’ingérence catastrophique de Napoléon en avait prouvé une fois pour toutes la nécessité – non seulement pour un art, mais pour un authentique métier, pratiqué par des négociateurs de haute volée, rompus aux question techniques et juridiques.
Tacticien de haute volée, Talleyrand a posé les jalons d’un nouvel ordre diplomatique conjuguant l’équilibre continental avec le respect des légitimités dynastiques. Les Cent-jours et le retour inattendu de Napoléon bouleversèrent un temps ses plans. Devenu président du Conseil, le premier de l’histoire de France, il se comportera en véritable souverain.
Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »