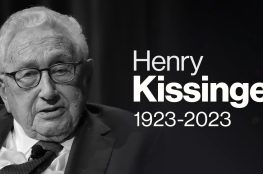Metternich « La révolution est le plus grand malheur qui puisse frapper un pays. Le révolutionnaire est l’héritier naturel de la folie politique », « j’ai été un rocher de l’ordre ». Opportuniste et fin stratège, se représentant comme la voix de l’Autriche, poursuivant son grand dessein : une paix fondée sur le principe de l’équilibre. Ce mécanisme est fondé sur la préservation de l’équilibre entre les grands Etats, reposant sur le maintien de leur intégrité territoriale.
Selon Canning, secrétaire au Foreign Office à propos de Metternich, « c’est le plus grand menteur de l’Europe et peut-être du monde civilisé ». Napoléon le confirme : « C’est le plus grand menteur du siècle. » Talleyrand en rajoute : « Metternich ment toujours mais ne trompe personne, au contraire de Mazarin qui trompait mais ne mentait pas. » En amante déçue, Dorothée de Lieven va aux extrêmes : « C’est le plus grand fourbe du monde. »
Ainsi, Metternich est un menteur. Cependant, Goethe, après un long entretien avec lui, le 26 octobre 1813, au lendemain du ralliement de l’Autriche à la coalition contre Napoléon et de la victoire des coalisés à Leipzig, le qualifie de grand homme d’Etat : « Il est de ces hommes qui nous inspirent l’assurance consolatrice … qu’une intelligence claire réglera bientôt la situation chaotique dans laquelle nous vivons. »
Une vie mouvementée
Une vie parsemée de paradoxes et de contradictions. Metternich est issu de l’aristocratie européenne, à rebours d’une époque qui sera bouleversée, seize ans après sa naissance, par le séisme de la Révolution française. Pour des générations d’Européens, il incarnera l’Autriche, mais il est un Autrichien de l’extérieur, de l’extrême occident du Saint Empire, et il ne découvrira l’Autriche qu’à vingt-deux ans.
A la naissance de Metternich, il n’y a ni Autriche ni empire d’Autriche, mais un souverain commun aux « royaumes et pays héréditaires situés à l’intérieur du Saint Empire ». Une union d’Etats avec pour chef un monarque appartenant à la maison d’Autriche, ce souverain autrichien étant, par ailleurs, « un empereur romain et roi de Germanie », en vertu de son élection à la tête du Saint Empire. Mais les possessions héréditaires autrichiennes ne sont pas toutes à l’intérieur du Saint Empire et nombre d’Etats du Saint Empire ne sont pas des possessions autrichiennes.
Itinéraire d’un diplomate
Metternich est né le 15 mai 1773 à Coblence, capitale de l’électorat de Trèves. En 1773, le Saint Empire poursuit sa lente déliquescence : selon le juriste allemand Samuel Pufendorf, il est devenu un « montre institutionnel, un corps informe qui ressemble à un monstre ». Cent vingt-cinq ans plus tôt, le congrès de Westphalie avait réduit le pouvoir impérial à une super-suzeraineté symbolique. A l’intérieur de ce « corps informe », l’électorat de Trèves et les principautés de Rhénanie respirent la douceur de vivre, à l’ombre de souverains.
Metternich a été formé au métier de diplomate par une institution exceptionnelle en son temps : l’école diplomatique de Strasbourg, dirigée par Christophe-Guillaume Koch, un « Montesquieu à l’accent alsacien ». Koch ne cesse de parcourir le continent pour susciter l’intérêt des cours européennes. Pour l’étudiant Metternich et ses condisciples, la politique étrangère, c’est d’abord le service du monarque. La diplomatie ne peut être que l’affaire des princes : il existe une famille des monarchies européennes ; les relations entre Etats sont rythmées par les rapprochements entre les maisons régnantes et leurs projets matrimoniaux.
Le philosophe diplomate David Hume, introduit trois décennies avant la naissance de Metternich le principe de l’équilibre : ce principe est l’axe du jeu diplomatique, le principe régulateur de l’anarchie internationale ; l’antithèse est l’aspiration à la monarchie universelle.
Le jeu des alliances
Devenu ambassadeur à Berlin en 1803, Metternich est totalement engagé dans la confrontation avec la France, trublion de l’Europe. Il mène campagne pour l’union des trois monarchies de l’Europe du Centre et de l’Est, l’Autriche, la Prusse et la Russie, afin de contenir l’élan guerrier de Bonaparte, avec l’appui du tsar Alexandre qu’il rencontre lors de sa visite à Potsdam.
Sur le principe, la conviction contre-révolutionnaire de Metternich reste intacte. Le diplomate autrichien marie le principe de l’équilibre à celui de la légitimité : leur poursuite suppose des valeurs communes, des principes d’organisation partagés, un accord sur les règles du jeu, sur un code de comportement, une certaine homogénéité au sein de ce que le nouvel ambassadeur appelle la « société des Etats ».
L’irruption de la France, puissance révolutionnaire, a détruit cette homogénéité et rendu vaine la recherche de la paix dans la durée : il n’y a plus de place que pour des armistices éphémères, non pour des engagements véritables. La proclamation de l’Empire, le 18 mai 1804, n’a pas modifié la nature révolutionnaire du régime politique de la France. Selon Metternich, « toutes les nations ont fait la même erreur en attachant dans une valeur de paix à un traité avec la France sans, en même temps, se préparer immédiatement pour la guerre.
A la fois révolutionnaire et conquérante, la France bouleverse les règles du jeu et la nature même de la négociation. Une « diplomatie d’usure » prend forme : les progrès sont lents ; il s’agit d’égarer l’adversaire, d’éroder sa volonté, de l’amener enfin à composer dans l’attente de jours meilleurs.
Metternich : opportuniste et manipulateur
Le diplomate Metternich se révèle opportuniste et manipulateur. Son symbole est l’araignée qui tisse sa toile et guette sa proie. En cette période de bouleversements, l’art du diplomate, selon lui, consiste à louvoyer, à gagner du temps, à masquer les intérêts de son pays sous de prétendus droits, à marier dogmatisme et futilité, expédients et principes, loyauté, duplicité et subterfuge. Le diplomate autrichien Metternich s’est fortement appliqué à transformer l’Autriche en un satellite de l’Empire napoléonien… allant jusqu’à engager un corps expéditionnaire aux côtés de la Grande Armée de la campagne de Russie.
L’intention de Metternich est d’élargir progressivement l’autonomie puis l’indépendance d’action de l’Autriche, afin de pouvoir changer de camp le moment venu. En face, Napoléon feint de croire à l’amitié maintenue de Vienne, à la force de ses liens de famille avec les Habsbourg. Son intention est de reconstituer son armée et d’impliquer son allié comme corps de secours pour ralentir l’avance des armées russes vers l’Europe centrale.
Cependant, Metternich déplace ses pions vers les autres puissances, à commencer par la Prusse et la Russie. Il insiste sur les différences de posture de la Prusse et de l’Autriche : la première peut se libérer d’une alliance « injuste », alors que la seconde doit tenir compte du « lien de famille ». Il présente au tsar sa démarche comme la seule rationnelle et s’oppose à l’élan messianique qui enflamme la Russie… Metternich propose la médiation de l’Autriche ; en réalité, il cherche à rassembler une coalition contre Napoléon. In fine, l’Autriche se rallie à la coalition et bouleverse, du même coup, le rapport de force entre les deux camps. Le rallié du dernier jour devient le chef de file de la coalition contre Napoléon, bientôt vaincu à Leipzig.
Ascension et déclin
La position internationale de Metternich s’est encore renforcée. Il est vraiment la voix de l’Autriche, le représentant d’un empire dont il peut élaborer la politique étrangère en toute liberté. Une situation exceptionnelle dans une Europe continentale dominée par ses monarques légitimes : le chancelier autrichien contribue à l’effacement de l’empereur François en s’imposant comme l’un des premiers rôles dans le concert des puissances, alors que le tsar et le roi de Prusse se maintiennent sur l’avant-scène européenne.
Le chancelier autrichien poursuit son grand dessein : une paix fondée sur le principe de l’équilibre, tendue vers la réconciliation avec la puissance défaite, vers sa réinsertion dans le nouveau concert monarchique.
Le nouveau concert européen prend l’allure d’un pur mécanisme politique, fondé sur la préservation de l’équilibre entre les grands Etats, reposant sur le maintien de leur intégrité territoriale, non de leur régime politique face à la multiplication des foyers d’agitation.
Cependant en 1848, une vague révolutionnaire déferle sur tout le continent, à l’exception de la Russie et de l’Angleterre. La révolution rattrape l’empire des Habsbourg. Metternich se félicitant de sa longévité politique face à l’instabilité des « régimes représentatifs » est chassé du pouvoir et se retrouve en exil.
Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »