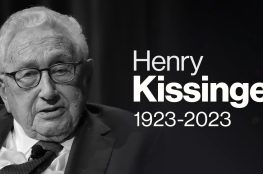Henry Kissinger, dans son ouvrage, Diplomatie, analyse le diplomate Benjamin Disraeli, en ces termes : pour Disraeli « l’empire représentait une nécessité non pas économique, mais spirituelle, et la condition requise pour assurer la grandeur de son pays ». Quant au biographe Danois Georg Brandes, il décrit Disraeli comme un personnage de roman ayant apporté un supplément d’âme à l’Angleterre victorienne, en en faisant une puissance semi-orientale, et un supplément de force et de subtilité à la rigide diplomatie européenne. Ainsi, on comprend que Disraeli avait parfaitement compris que l’imagination était la première force en politique et plus encore en diplomatie, qu’il fallait être capable en permanence de concevoir le futur, avec toujours une conscience profonde de l’histoire.
Benjamin Disraeli, né le 21 décembre 1804 dans une famille séfarade originaire de Ferrare. Homme marqué par ses origines, fasciné par l’Orient et dominé par les influences littéraires les plus cosmopolites, il est devenu par la suite le rénovateur du conservatisme en Angleterre, le porte-drapeau d’une jeunesse aristocratique et romantique, et le chantre de l’Empire Britannique.
Disraeli a su s’identifier à la grandeur de son pays et au destin de son peuple, entraînant dans son sillage toute une génération politique. Grand diplomate et homme d’Etat de premier ordre, il a marqué profondément de son empreinte l’histoire de l’Angleterre et de l’Europe, provoquant l’admiration de son contemporain Bismarck, plus tard celle de Charles de Gaulle.
Parcours politique
Benjamin Disraeli renonce aux études universitaires, voie pourtant royale pour accéder aux cercles du pouvoir. Grâce à son père, il s’introduit dans le milieu des éditeurs, notamment le plus célèbre et le plus influent du temps, John Murray. Cependant, il manifeste très tôt son intérêt pour la politique, et l’étude de l’histoire. Mettant en exergue l’importance de l’expérience et de la tradition dans la construction des nations et de leurs libertés. A l’opposé du concept d’« utilitarisme » de Bentham, qui est un courant philosophique incarné à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle par Jeremy Bentham, adapté à l’esprit de productivité et de rentabilité de la révolution industrielle, et qui fonde la morale collective sur la recherche du maximum de bonheur individuel pour le plus grand nombre.
En février 1868, Disraeli devient Premier ministre. Son premier passage au pouvoir est court, mais lui permet de resserrer les liens avec la reine. Renvoyé dans l’opposition, il réinvestit son rôle de leader aux Communes, menant une guerre sans relâche contre Gladstone.
La victoire de la Prusse sur la France en 1870, l’unification de l’Allemagne sous l’égide de Bismarck donnent un nouveau cours à sa carrière. Tout en s’intéressant activement à la diplomatie, il avait surtout bataillé sur des questions directement liées à la politique intérieure : protectionnisme et libre-échangisme, réforme électorale, statut de l’Inde, question d’Irlande. Confronté, cette fois, à un fait historique majeur, alertant Napoléon III, lui disant même de Bismarck : « Méfiez-vous de cet homme, il pense ce qu’il dit. » La menace d’une hégémonie allemande en Europe crée une forme de révolution en Europe.
Disraeli ne parle qu’une seule langue étrangère, qui est le français, langue diplomatique, mais de manière imparfaite. Possédant par ailleurs, des qualités certaines : une grande intelligence, connaissance des hommes due à sa longue expérience en politique, ainsi qu’une capacité de manœuvrer et une hauteur de vues historique, géographique et géopolitique. Possédant une imagination débordante.
En janvier 1876, Benjamin Disraeli dépose sans préavis un projet de loi créant le titre d’impératrice des Indes. La loi est votée le 16 mai 1876, et, le 1er janvier 1877, la Proclamation Durbar, à Delhi, fait de la reine Victoria la première impératrice des Indes.
Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »