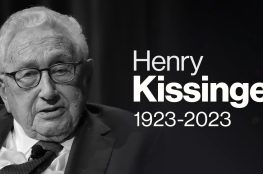La postérité a reconnu en Kaunitz un des plus grands diplomates de la monarchie autrichienne. Sa haute intelligence, sa parfaite maitrise des dossiers, ont été mises, pendant quarante ans, au service de quatre souverains. Son fait d’armes le plus célèbre fut le renversement des alliances lorsqu’il était le collaborateur de Marie-Thérèse. Il est d’ailleurs représenté sur le monument élevé en 1888, à Vienne, par le sculpteur Kaspar von Zumbusch à la gloire de la grande souveraine.
Né en 1711 à Vienne, il est issu d’une des plus grandes familles de l’aristocratie morave qui a déjà donné à la monarchie de nombreux serviteurs. Son grand-père, le comte Dominik Andreas von Kaunitz, a notamment exercé les fonctions prestigieuses de Reichsvizekanzler (vice-chancelier d’Empire), dans lesquelles il a été nommé par Léopold 1er (1685-1765). Chargé de ce poste, il a également conduit auprès de l’empereur la politique extérieure de la monarchie. Ce grand personnage sert de modèle à son fils Maximilian Ulrich, puis à Wenzel Anton, qui rêve d’inscrire ses pas dans ceux de son grand-père.
Maximilian Ulrich veille de près à l’éducation de son héritier. Il recrute un précepteur qui sera chargé de superviser l’éducation de l’adolescent. Son choix se porte sur Johannes Schwanau, un disciple de Christian Thomasius et de Christian Wolf, les premiers philosophes de l’Aufklarung – comprenons les Lumières dans l’espace germanique. Cette première phase terminée, il accompagne son élève à l’université de Leipzig. Wenzel Anton von Kaunitz s’y initie aux droits public et privé, approfondit sa connaissance de l’histoire allemande, se familiarise avec l’art de la rhétorique et, parfait sa maîtrise du latin.
Au cours d’un périple de plus d’un an et demi, il visite plusieurs capitales européennes : Berlin, la Haye, Paris, Turin. C’est l’occasion pour lui de découvrir des horizons nouveaux politiques, économiques, sociaux, culturels. Ces connaissances seront primordiales pour sa carrière diplomatique.
L’ascension fulgurante
Avec la montée au trône en 1740 de Marie-Thérèse, la carrière de Kaunitz s’accélère. A seulement 31 ans, brûlant les étapes, il est nommé ambassadeur à Turin, un poste stratégique puisque la Savoie balance traditionnellement entre Vienne et Versailles. Le moment est critique : en décembre 1740, Frédéric II, le nouveau roi de Prusse, a envahi la Silésie autrichienne, et la guerre fait toujours rage entre les deux monarchies. De plus, une coalition antiautrichienne s’est formée en 1741 sous l’égide de Louis XV. Kaunitz réussit à détacher la Savoie du camp français et à la convaincre de s’allier à Vienne, ce qui est fait le 13 septembre 1743.
Marie-Thérèse nomme Wenzel Anton von Kaunitz pour la représenter dans les négociations qui doivent mettre fin à la guerre de Succession d’Autriche et qui aboutissent effectivement au traité d’Aix-la-Chapelle du 26 octobre 1748. Ainsi, Kaunitz franchit une étape importante dans la progression de sa carrière.
A son retour à Vienne : il est appelé à siéger à la Geheime Konferenz (« Conférence secrète »), la plus haute instance délibérative de la monarchie autrichienne. La thèse défendue et approfondie par Kaunitz qu’il avait développé dans son mémoire de 1743, il tire pour enseignement de la guerre récente que la Prusse a remplacé la France comme principal ennemi des Habsbourg : « Le roi de Prusse, doit être considéré comme l’ennemi le plus grand, le plus dangereux, le plus irréconciliable de l’auguste maison archiducale ». C’est sur ce constat que la monarchie doit fonder sa politique, en définir les buts et déterminer les moyens appropriés pour les atteindre.
Chancelier d’Etat
Marie-Thérèse a rappelé Kaunitz dans l’intention de le placer à la tête de la chancellerie d’Etat et de lui confier ainsi la direction de la politique extérieure de la monarchie. Ayant la certitude de posséder en lui le plus grand ministre d’Europe.
L’année 1755, représente un tournant dans les relations avec la France. Lorsque les tensions entre Londres et Versailles s’aggravent au point de rendre sérieuse la menace d’une nouvelle guerre, le cabinet anglais intervient auprès de Marie-Thérèse pour qu’elle renforce son dispositif militaire dans les Pays-Bas. Or, en parfait accord avec son chancelier d’Etat, la souveraine oppose une fin de non-recevoir à cette demande.
Traité de Westminster, signé le 16 janvier 1756, est un traité de neutralité entre la Prusse et la Grande-Bretagne
Frédéric II, roi de Prusse, croit pouvoir concilier son alliance avec la France et un rapprochement avec l’Angleterre. Convaincu qu’après des siècles d’hostilité une alliance entre les cours de Vienne et de Versailles relève du domaine de la fiction. Il amorce un rapprochement avec Londres, qui aboutit, le 16 janvier 1756, au traité de Westminster par lequel s’engage à ne pas attaquer le Hanovre, possession personnelle du roi d’Angleterre sur le continent.
Traité de Versailles, signé le 1er mai 1756
Traité d’alliance conclu entre Louis XV et Marie-Thérèse d’Autriche. Ce traité défensif, stipule que la France et l’Autriche se garantissent réciproquement leurs Etats et conviennent que, si l’une des deux puissances est attaquée en Europe par un tiers, l’autre lui portera secours avec une armée de 24.000 hommes. Ce traité consacre le renversement des alliances entre les parties contractantes dont Kaunitz est l’artisan principal du côté autrichien. Pour Vienne, la clause la plus importante stipule que la France soutiendra militairement l’Autriche si celle-ci est attaquée par la Prusse.
La guerre de Sept ans (1756-1763)
Le traité de Versailles se veut la première pierre d’un nouveau système diplomatique organisé autour de trois pôles : Vienne, Versailles et Saint-Pétersbourg. L’Autriche et la Russie sont déjà liées depuis 1746, mais c’était du temps de l’alliance anglo-autrichienne. Le 1er mai 1757, le second traité de Versailles est signé, aux termes duquel Louis XV s’engage à verser des subsides à l’Autriche et à intervenir en Allemagne avec l’envoi d’un corps expéditionnaire.
La guerre de Sept Ans est la première guerre véritablement mondiale : on se bat sur plusieurs fronts, en Europe, en Amérique et en Inde. C’est un renversement des alliances qui voit s’opposer principalement la France, alliée à l’Autriche, contre la Prusse, alliée à l’Angleterre. Le Prussien Frédéric II est en infériorité numérique, mais son armée, très bien équipée, est la mieux entraînée. De cette longue lutte, la Prusse sort grandie et la France abaissée. Frédéric II doit la victoire à son génie militaire et à sa ténacité autant qu’à la médiocrité de ses adversaires, qui n’ont pas su combiner leurs efforts et saisir les occasions décisives. La fin de la guerre, en 1763, consacre l’échec des prétentions françaises et couronne la volonté britannique : la France est évincée du continent nord-américain et perd l’essentiel de ses possessions aux Indes. Cette guerre s’avère désastreuse pour Louis XV, qui a sacrifié 200 000 hommes en Allemagne pendant qu’il perdait ses colonies faute de troupes pour les défendre.
Le Staatsrat
Kaunitz s’implique aussi dans les affaires intérieures de la monarchie. C’est lui qui porte notamment en 1760 le Staatsrat (« Conseil d’Etat ») sur les fonts baptismaux. Sa création est le fruit de la réflexion du chancelier sur les dysfonctionnements apparus dans l’appareil gouvernemental face à l’épreuve de la guerre. La création du Staatsrat marque, de toute évidence, une nouvelle étape dans l’ascension de Kaunitz. Si la fonction de Premier ministre n’existe pas dans le système gouvernemental autrichien, nul doute qu’il soit devenu le premier des ministres. Dans cette nouvelle instance siègent seulement le chancelier d’Etat et le président du Conseil aulique de la Guerre. Le Staatsrat devait travailler en comité restreint. Il ne devra pas compter plus de huit membres. Il se réunira deux fois par semaine, une fréquence qui va rapidement l’aider à tenir le rôle central souhaité par Kaunitz. Le Staatsrat n’a de comptes à rendre qu’à la souveraine, ce qui garantit sa discrétion et son influence.
Source : Hubert Vedrine « Les Grands Diplomates »