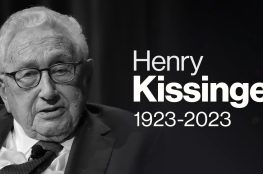Gérard Araud, dans son livre diplomatique de la France entre 1919 et 1939, « Nous étions seuls ». Nos alliés étaient protégés par la Manche, l’océan Atlantique et leurs flottes de guerre. Aristide Briand était conscient des faiblesses françaises : une faible natalité, presque plus de décès que de naissances, une industrie dévastée par le conflit alors que celle de l’Allemagne était intacte, des finances faibles, dont l’état a été aggravé par les spéculateurs britanniques et américains. Mais grâce à sa ténacité, Briand a acté un début de réconciliation franco-allemande, et aussi poser les fondations de l’Union européenne.
En 1902, Briand est élu député à Saint-Etienne. Dès 1903, il devient rapporteur de la commission parlementaire nouvellement créée chargée de proposer un projet de séparation des Eglises et de l’Etat. Le 30 juillet 1904, la France et le Saint-Siège rompent leurs relations diplomatiques à la suite de la visite au roi d’Italie du président de la République Emile Loubet, le pape Pie X se considérant comme prisonnier dans son palais du Vatican à Rome.
Briand va ainsi travailler à un projet de séparation, mais dans un esprit de conciliation. D’obédience agnostique voire athée, son projet est une Eglise libre dans un Etat libre. Aristide Briand s’initie progressivement aux relations internationales. In fine, alors que l’Europe voit resurgir les conflits (guerre italo-turque pour le contrôle de la Libye, affrontements balkaniques et surtout augmentation des effectifs de l’armée allemande), Briand comprend rapidement que la France se trouve menacée : en février 1913, le Kaiser est à même d’aligner 875.000 hommes contre 480.000 soldats français. Redevenu président du Conseil en mars, Briand suit les recommandations des militaires et propose à la Chambre un service militaire de trois ans, au lieu de deux ans. Grâce aux accords Sykes-Picot qui prévoient le découpage des provinces arabes de l’Empire ottoman, la France obtiendra de la Société des Nations un protectorat sur la Syrie et le Liban. L’administration américaine réclame avec insistance à la France le remboursement intégral de ses dettes, refusant systématiquement tout lien avec le versement des réparations allemandes. Quant à la France, elle joue le respect intégral du traité : occupation de la Rhénanie pour cinq, dix ou quinze ans selon les zones, désarmement du Reich, et réparations allemandes élevées pour reconstruire les régions dévastées du nord et de l’est du pays.
La doctrine politique d’Aristide Briand
En janvier 1921, Briand est rappelé au pouvoir par le président de la République Alexandre Millerand, et la majorité de droite du Bloc national, appuyée par de nombreux radicaux. Aristide Briand sait pertinemment que l’Allemagne ne pourra payer que si elle redevient une puissance exportatrice forte, impliquant un relèvement industriel du Reich et donc le risque de reconstitution d’un potentiel de guerre. Privilégiant la sécurité, cela implique une Allemagne impuissante et appauvrie, donc incapable de payer ce qu’elle doit. In fine, face à une Allemagne n’ayant pas subi de destructions, et disposant d’un outil industriel intact, comptant soixante millions d’habitants contre quarante millions en France, Aristide Briand sait pertinemment que l’armée française ne peut rivaliser avec l’armée allemande. Donc, il lui faut soit la garantie anglaise, soit des accords de coopération progressive avec Berlin, afin de se diriger vers une paix durable.
Rapidement la situation évolue. L’Allemagne a retrouvé sa prospérité grâce à une réforme monétaire appuyée par Londres et Washington. Aristide Briand propose dès mai 1925 que l’Allemagne doit entrer à la SDN afin de l’enfermer dans un système multilatéral. Un accord est finalement trouvé en dix jours. Le « pacte rhénan » garantit le statu quo territorial entre la Belgique et la France, d’une part, et l’Allemagne, d’autre part : celle-ci confirme la possession par la France de l’Alsace-Lorraine et des cantons d’Eupen et Malmédy par la Belgique, et que les différends entre ces trois pays soient réglés par arbitrage ou devant la SDN. Londres et Rome apportent leur garantie à ce pacte.
En septembre 1926, l’Allemagne est admise à la SDN comme membre permanent de son conseil. Briand est devenu ministre des Affaires étrangères de Poincaré (président du Conseil de novembre 1925 à juillet 1926). En ce même mois de septembre 1926, les sidérurgistes français, belges, luxembourgeois et allemands créent, sous l’impulsion de l’industriel du grand-duché Emil Mayrisch, une « Entente internationale de l’acier », cartel européen qui fixe des quotas de production pour mettre un terme à la concurrence exacerbée des industriels : 40% pour l’Allemagne, 32% pour la France, 12,5% pour la Belgique, 8,5% pour le Luxembourg et 7% pour la Sarre. En effet, c’est l’ancêtre de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, mise sur pied en 1951).
Source : Hubert Védrine « Les Grands Diplomates »